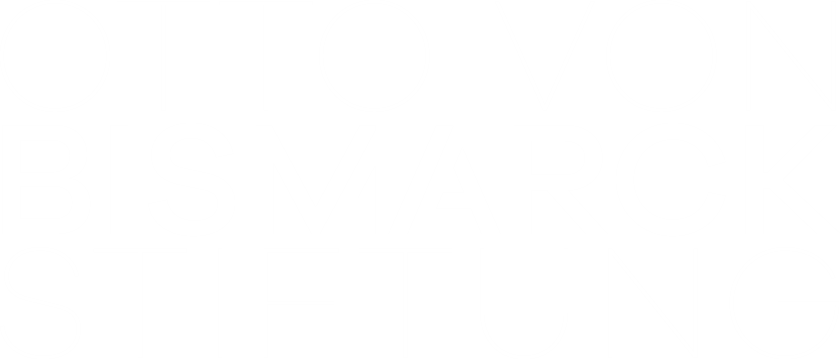Brief an Robert Salisbury, Berlin, 22. November 1887
Originalfassung in Französisch
Monsieur le Marquis,
Dans les pourparlers qui ont eu lieu entre Votre Excellence et le comte Hatzfeldt afin de préciser l’appréciation anglaise de l’entente austro-italienne par rapport aux intérêts communs que ces deux Puissances ont en Orient, j’ai puisé la conviction qu’un échange d’idées direct entre nous pourrait être utile aux intérêts de nos deux pays, et contribuer à écarter de part et d’autre quelques-uns des doutes qui peuvent subsister au sujet des buts politiques que nous poursuivons de part et d’autre.
Nos deux nations ont en effet tant d’intérêts communs, et il y a un si petit nombre de points sur lesquels des divergences de vues peuvent se produire, que nous sommes à même d’admettre dans nos ouvertures mutuelles plus de franchise que les habitudes de notre diplomatie ne comportent d’habitude. La confiance que nous avons de part et d’autre dans la loyauté personnelle l’un de l’autre nous permet de donner une étendue plus vaste encore à cette franchise. Au sujet de la politique anglaise la publicité de votre régime parlementaire nous offre une source suffisante d’informations, tandisque la manière moins transparente dont les affaires se traitent chez nous peut devenir une cause d’erreurs difficiles à éviter, comme par exemple celle, que commet Votre Excellence en exprimant l’appréhension que le Prince Guillaume pourrait, lorsqu’il tiendrait un jour les rênes du Gouvernement, incliner systématiquement à une politique hostile à l’Angleterre. Pareille chose ne serait pas possible en Allemagne – ni le contraire non plus. De même que Son Altesse Impériale le Prince de la Couronne ne voudrait et ne pourrait un jour, étant Empereur, faire dépendre sa politique d’inspirations anglaises, de même aussi le Prince Guillaume, se trouvant à sa place, ne penserait pas à faire et serait dans l’impossibilité de faire sa politique en suivant les impulsions venant de St. Pétersbourg. Les deux Princes lorsqu’ils seront appelés à régner, l’un et l’autre suivront exactement la même ligne de conduite: en obéissant à leurs sentiments personnels aussi bien qu’à la force de la tradition monarchique; ils ne voudront et ne pourront s’inspirer d’autres intérêts que de ceux de l’Allemagne. Or, la route à suivre pour sauvegarder ces intérêts est tracée d’une manière tellement rigoureuse qu’il est impossible de s’en écarter. Il ne serait pas raisonnable d’admettre, que le Gouvernement d’un pays de 50 millions d’habitants – considérant le degré de civilisation et la puissance de l’opinion publique existant en Allemagne – pourrait infliger à ce pays les souffrances qui accompagnent et suivent toute grande guerre, victorieuse ou non, sans fournir à la nation des raisons assez graves et assez claires pour convaincre l’opinion publique de la necessité de la guerre. Avec une armée telle que la nôtre, qui se recrute indifféremment dans toutes les classes de la population, qui représente la totalité des forces vives du pays et qui n’est que la nation en armes – avec une telle armée les guerres des siècles passés, résultant de sympathies, d’antipathies ou d’ambitions dynastiques, ne pourraient se faire. Depuis prés d’un quart de siècle l’Allemagne forme annuellement 150 000 soldats, de manière à pouvoir disposer aujourd’hui de 3 à 4 millions d’hommes, âgés de 20 à 45 ans et rompus au service militaire. Pour toute cette multitude d’hommes nous possédons, non seulement les armes et les objets d’équipement nécessaires, mais même les officiers et sous-officiers pour les conduire au combat. Nos cadres sont complets – avantage dont en fait d’officiers et de sous-officiers aucune autre nation ne pourrait se vanter.
Ces millions d’hommes sans exception accourent au drapeau et se placent sous les armes aussitôt qu’une guerre sérieuse menace l’indépendance nationale et l’intégrité de l’Empire. Mais ce grand appareil de guerre est trop formidable pour que, même dans notre pays, imbu du sentiment monarchique, il puisse être arbitrairement mis en branle par la simple volonté royale; il faudrait au contraire que les Princes et les Peuples de l’Empire soient unis dans la pensée, que la patrie, son indépendance et son unité récemment faite, se trouvent en danger, pour que ces grandes levées d’hommes puissents s’effectuer sans danger. Il s’en suit que notre force militaire est en première ligne un appareil défensif, destiné à n’entrer en action que lorsque la nation aura acquis la conviction, qu’il s’agit de repousser une aggression. L’Allemagne a peu d’aptitude à faire d’autre guerre qu’une guerre défensive. – En appliquant ce qui précède à un cas spécial, il ressort de l’état des choses en Allemagne que le Gouvernement de l’Empire ne pourrait pas assumer devant la nation la responsabilité d’une guerre, dans laquelle d’autres intérêts que ceux de l’Allemagne se trouveraient en litige, comme par exemple ceux de l’Orient. – Le sultan est notre ami et il a toutes nos sympathies; mais de là jusqu’à nous battre pour lui, il y a une distance que nous ne pourrons proposer au peuple allemand de franchir.
En faisant ces déclarations, je ne veux pas faire supposer, que rien qu’une attaque directe contre nos frontières serait capable de justifier un appel aux armes des forces allemandes. L’Empire allemand a trois grandes puissances pour voisins, et ses frontières sont ouvertes. Il ne doit donc pas perdre de vue la question des coalitions qui pourraient se former contre lui. Si nous supposons l’Autriche vaincue, affaiblie ou devenue ennemie, nous serions isolés sur le continent de l’Europe en prèsence de la Russie et de la France, et en face de la possibilité d’une coalition de ces deux puissances. Il est de notre intérêt d’empêcher même par les armes que pareil état de choses puisse s’établir. – [L’existence de l’Autriche comme Grande Puissance forte et indépendante est une nécessité pour l’Allemagne à laquelle les sympathies personnelles du souverain ne peuvent rien changer. – L’Autriche, de même que l’Allemagne at l’Angleterre d’aujourd’hui, appartient au nombre des nations satisfaites, «saturées» au dire de feu le prince Metternich et partant pacifiques et conservatrices. L’Autriche et l’Angleterre ont loyalement accepté le status quo de l’Empire allemand et n’ont aucun intérêt de le voir affaibli. La France et la Russie au contraire paraissent nous menacer: la France en restant fidéle aux traditions des siècles passés qui la montrent comme ennemie constante de ses voisins, et par suite du caractère national des Français; la Russie en prenant aujourd’hui vis-à-vis de l’Europe l’attitude inquiétante pour la paix européenne qui caractérisait la France sous les règnes des Louis XIV. et de Napoleon I. C’est d’un côte l’ambition des meneurs slaves à laquelle incombe la responsabilité de cet état de choses: d’un autre côte il faut chercher les causes de l’attitude provocante de la Russie et de ses armées, dans les questions de sa politique intérieure: les révolutionnaires russes espérent qu’une guerre étrangère les débarrassera de la monarchie; les monarchistes au contraire attendent de cette même guerre la fin de la révolution. Il faut considérer aussi le besoin, d’occuper une armée oisive et nombreuse, de donner satisfaction à l’ambition de ses généraux, et de détourner vers la politique étrangère l’attention des libéraux qui demandent des changements de constitution. Vu cet état de choses nous devons considérer comme permament le danger de voir notre paix troublée par la France et la Russie. Notre politique par conséquent tendra nécessairement à nous assurer les alliances qui s’offrent en vue de l’éventualité d’avoir à combattre simultanément nos deux puissants voisins: si l’alliance des puissances amies menacées par les mêmes nations belliqueuses nous faisait défaut notre situation dans une guerre sur nos deux frontiéres ne serait pas désespérée; mais la guerre contre la France et la Russie coalisées, en supposant même que comme exploit militaire elle finirait aussi glorieusement pour nous que la guerre de sept ans, serait toujours une assez grande calamité pour le pays pour que nous tâcherions de l’éviter par un arrangement à l’amiable avec la Russie s’il fallait la faire sans allié. Mais tant que nous n’avons pas la certitude d’être délaissés par les puissances dont les intêréts sont identiques aux nôtres, aucun empereur de l’Allemagne ne pourra suivre une autre ligne politique que celle de défendre l’indépendance des puissances amies, satisfaites comme nous de l’état actuel de l’Europe et prêtes à agir sans hésitations et sans faiblesses quand leur indépendance serait menacée. Nous éviterons donc une guerre russe autant que cela sera compatible avec notre honneur et notre sécurité, et autant que l’indépendance de l’Autriche-Hongrie, dont l’existence comme Grande-Puissance est d’une nécessité de premier ordre pour nous, ne soit pas mise en question. Nous désirons que les puissances amies qui en Orient ont des intérêts à sauvegarder qui ne sont pas les nôtres, se rendent assez fortes par leur union et leurs forces pour retenir l’épée de la Russie au fourreau ou pour y tenir tête en cas que les circonstances amèneraient une rupture. Tant qu’aucun intérêt de l’Allemagne s’y trouverait engagé, nous resterions neutres; mais il est impossible d’admettre que jamais Empereur allemand puisse prêter l’appui de ses armes à la Russie pour l’aider à terrasser ou à affaiblir une des Puissances sur l’appui desquelles nous comptons, soit pour empêcher une guerre russe, soit pour nous assister à y faire face. A ce point de vue la politique allemande sera toujours obligée à entrer en ligne de combat, si l’indépendance de l’Autriche-Hongrie était menacée par une agression russe, ou si l’Angleterre ou l’Italie risquaient, d’être entamées par des armées françaises. La politique allemande procède ainsi sur une route forcément prescrite par la situation politique de l’Europe et dont ni les antipathies, ni les sympathies d’un Monarque ou d’un ministre dirigeant pourraient la faire dévier.
Je me flatte de l’espoir que Votre Excellence voudra reconnaître la justesse des raisonnements de cet exposé que je viens de faire. Quant à moi, je le répète, j’y reconnais d’une manière tellement absolue les principes de la politique que l’Allemagne est et sera forcée de suivre, que les sympathies les plus chaleureuses pour une Puissance étrangère ou pour un parti politique quelconque ne pourraient cependant jamais offrir la possibilité à un Empereur allemand ou à son Gouvernement de s’en écarter.
Je prie Votre Excellence d’agréer l’expression de mes sentiments très-devoués.